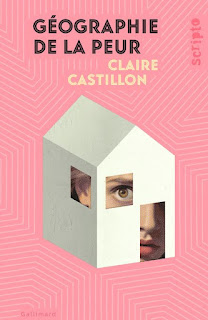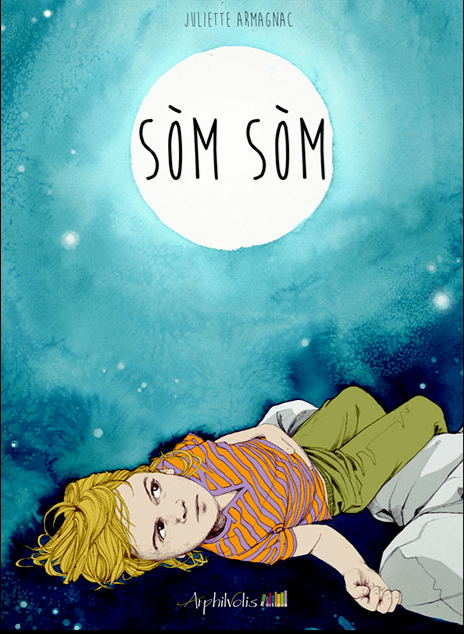mercredi 16 octobre 2024
Francœur - À nous la vie d'artiste !
dimanche 6 octobre 2024
La dernière fois qu'on s'est aimés
Dans le bus magique de Marie Boulic
« Elle » est assise dans son autobus, le nez plongé dans Melville, quand, levant la tête, elle voit « Lui » monter, ce qui lui occasionne d'emblée, page une, « une petite descente d'organes », comme dirait son amie Scarlett. Pourquoi tant d'émotion pour une histoire pliée, finie, terminée depuis dix-huit mois ? Commence alors un drôle de duel, entre « elle » et « lui » que Charlie - « elle » s'appelle Charlie – aurait pu intituler « Coincée dans un bus avec mon ex » si elle en avait fait un roman. L'ex, « Lui », s'appelle Raphaël et comme il ne l'a pas aperçue d'emblée, il finit par s'asseoir en face d'elle, par hasard on va dire (mais on sait bien ce qu'il faut penser du hasard).
Marie Boulic met en scène ces retrouvailles forcées par glissements progressifs, passant de deux monologues intérieurs à l'échange, inévitable, inéluctable et embarrassant au possible. Narratrice ô combien omnisciente, elle se place à tour de rôle dans la tête de chacun, s'amusant à les voir reprendre langue intime l'un avec l'autre dans cet espace ô combien collectif qu'est un autobus aux heures de pointe. Drôle de huis-clos ouvert sur le monde où le passé va devoir se reconjuguer au présent parce que ces deux-là n'ont jamais cessé de s'aimer malgré la chose violente qui les a séparés.
Cette chose-là est au milieu d' « Eux », une autre focale qu'emploie l'autrice qui nous fait entrer peu à peu dans ce qui a précédé cette rencontre impromptue, la séparation, si proche si lointaine, le coup de foudre initial, en intercalant dans ce face à face, des analepses qui nous font découvrir les premiers pas du couple. Ce qui lui permet d'offrir à son récit deux styles bien différents : celui des vers libres, qui accueillent le maelstrom des émotions, des mots qui brûlent au-dedans, des cassures du langage quand celui-ci, après avoir hésité, s'élance dans la parole pour enflammer le bus ; celui de la prose plus sage qui raconte, explique, sorte de petit chœur antique portatif qui nous ramène aux origines du couple et de ce qui l'a fait et défait.
La dernière fois qu'on s'est aimés aurait pu s'appeler La place vide, signalée page 188, cette place où aucun des deux ne peut ni ne veut s'asseoir, car c'est la place de la « chose » qui est entre eux et qui les a déchirés. Dans le titre, « dernière » sonne comme « dernière irrévocable », comme si le théâtre de la vie pouvait fermer définitivement ! Mais non ! Car la dernière fois qu'on s'est aimés, c'était tellement bien, qu'on n'a rien oublié et même, qu'on va recommencer. Encore frissonnants...
En cette rentrée littéraire, le roman de Marie Boulic ne serait-il pas le plus beau plaidoyer qui soit en faveur du réarmement amoureux ?
La dernière fois qu'on s'est aimés - Marie Boulic - septembre 2024 - Sarbacane (231 pages, 15,50 €)
NB : En trois romans, Nos étés sauvages, Le chant du bois ( Grand prix SGDL du roman jeunesse 2024) et maintenant La dernière fois qu'on s'est aimés, Marie Boulic s'est imposée dans la LJ comme une nouvelle voix qui "ne chante pas pour passer le temps".
vendredi 5 juillet 2024
Géographie de la peur
J'ai découvert Claire Castillon avec son roman Les longueurs, que je vous avais présenté ici même en octobre 2022 et qui avait reçu quelques jours plus tard le prix Vendredi. La croisant la semaine dernière dans le cadre du Livrodrome qui stationnait à Lons-le-Saunier, j'ai acheté son nouveau livre, intitulé Géographie de la peur.
Claire Castillon nous entraîne cette fois-ci à l'intérieur de Maureen, une jeune fille de 18-19 ans, qui souffre d'un TAG – non, un TAG, ce n'est pas un graffiti tracé sur un mur, c'est l'acronyme pour « trouble anxieux généralisé ». Elle vit encore chez ses parents et a le plus grand mal à sortir de chez elle pour aller à la fac.
L'autrice a confié la narration à Maureen, qui se fait pour nous géographe de sa peur, nous entraînant dans les méandres de son esprit. Qui ne connaît pas aujourd'hui un ado qui n'arrive plus à se lever le matin pour aller au collège ou au lycée, un jeune auquel en désespoir de cause on a collé l'étiquette de « phobique scolaire » ? Ou bien quelqu'un qui a de soudaines et incompréhensibles « attaques de panique » dans la rue, dans un magasin ? Cette cause désespérée, l'héroïne de Claire Castillon nous la fait explorer, en compagnie de ses parents, de son frère Alex, de Jérôme son infatigable ami et de quelques camarades de classe qu'elle n'a pas encore totalement lassés avec ce qu'ils nomment tous son « truc ».
C'est que faute d'identifier une cause, faute d'entrer dans un catalogue de maladies répertoriées, le mal-être de Maureen, son « truc », reste inclassable. Elle nous répète à plusieurs reprises qu'elle est ainsi depuis dix-neuf mois, ce qui laisse penser au lecteur qu'un événement traumatique est à l'origine de son état mental et de ses malaises, que cet événement va nous être décrit, et qu'il nous fera comprendre quelque chose.
En attendant cette révélation, Maureen galère, n'arrivant plus à sortir de chez elle. L'autre pilier dans sa vie, en dehors de Jérôme, c'est son psy, le Dr Mary dont elle a dû concéder l'emploi à ses parents mais dont le leitmotiv - « et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » - ne suffit pas toujours à donner du sens aux séances et à la vie de sa patiente.
Au bout de quelques mois, un emploi d'hôtesse va fournir à Maureen cette sorte d'armure qui lui manquait pour affronter le monde qui l'entoure, qu'elle perçoit tout en aspérités et en reliefs menaçants. Alors qu'elle avait régulièrement, lors de ses crises, la sensation de se détacher intérieurement d'elle-même, ce qui la conduisait à une sorte de paralysie de son être, ses fonctions d'hôtesse lui permettent en quelque sorte de se dédoubler plus objectivement et de confier à un personnage, en uniforme, le soin d'affronter le monde extérieur à l'aide de comportements codifiés, par une sorte de pilotage automatique.
La caméra subjective de Claire Castillon entraîne le lecteur dans le vertige intérieur de Maureen, avec une force saisissante. L'incommunicable nous est communiqué pendant que l'entourage de la jeune femme semble rester à l'extérieur, incapable d'interpréter correctement les signaux désordonnés qu'elle lui envoie. Peu à peu pourtant se dessine un chemin, qu'on dirait de « résilience », peut-être parce qu'en dépit des maladresses des uns des autres, Maureen n'est pas rejetée et reste entourée. Du moins Claire Castillon a-t-elle voulu qu'il en soit ainsi et que Maureen puisse entrevoir la sortie de cette « cage invisible » dont elle a elle-même, comme elle le dit, « dessiné les contours afin de se protéger de son cerveau ». Par une boucle du récit, l'autrice suggère in fine que l'écriture aura été une voie de salut pour son héroïne, manière peut-être pour Claire Castillon de nous dire quelque chose d'elle-même.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:42) :
Géographie de la peur – Claire Castillon – collection Scripto, Gallimard Jeunesse (165 pages, 10,50 €)
vendredi 28 juin 2024
Le soleil est nouveau chaque jour
Ils avaient la tête en vrac à force de soirées fumette et alcool. Le monde tel qu'il était ne leur plaisait guère mais ils attendaient qu'il change. Et puis un beau jour, ils se sont décidés à conjuguer le verbe agir au présent. Ils ont répondu à un appel lancé sur Internet, ils ont traversé la France dans la vieille Clio de Fatou et ils se sont retrouvés perchés à quinze mètres de hauteur, dans des cabanes posées sur de vieux chênes promis à l'abattage, rejoignant un combat entamé par d'autres.
L'enjeu : protéger un beau morceau de forêt de Lorraine, promis à la destruction par un projet d'entrepôt géant porté par une multinationale américaine et un maire d'une petite commune séduit par la promesse de quelques dizaines d'emplois plus ou moins précaires.
Leur seule chance de réussir : mobiliser la presse et l'opinion en faveur de leur cause avant que la police n'entreprenne de les déloger.
En écrivant Le soleil est nouveau chaque jour, Eric Pessan a composé une sorte de manuel du parfait petit zadiste, mais vu de l'intérieur, puisque c'est Thomas, l'un des protagonistes, qui raconte cette aventure collective. Il est arrivé de Nantes avec Fatou, Antoine et surtout Klara, une jeune réfugiée ukrainienne, avec laquelle il est en couple depuis quelques mois.
Ils ont prévu de tenir trois semaines, en emportant des vivres en conséquence. Thomas tient une sorte de journal de l'occupation, mais l'auteur a pris soin de casser une narration trop linéaire. Il décrit notamment l'évolution de Thomas dans son environnement familial, avec un père très engagé dans sa commune, qui est à l'évidence son modèle, quoique cet engagement n'ait laissé que la portion congrue à sa relation avec ses enfants, Thomas et sa sœur Julie.
Nous sommes à l'ère du portable, des réseaux, qui permettent de communiquer, de poster des films, des commentaires sur l'action entreprise sans qu'il soit nécessaire de redescendre à terre. C'est le soleil, ce soleil nouveau chaque jour selon le mot d'Héraclite*, qui recharge les téléphones.
Et bientôt l'action des seize jeunes gens, cinq filles et onze garçons, va être connue des journalistes et du grand public. L'intervention des gendarmes est guettée. Les jeunes comptent sur le fait qu'un assaut serait trop dangereux et à l'évidence ce n'est pas cette option qui est prise. Du moins au début.
Les jeunes activistes vont vite mesurer la versatilité des médias qui ne se nourrissent que de nouveautés. Ils vont essayer néanmoins d'entretenir leur intérêt en variant interviews, récits. Obtiendront-ils gain de cause, en l'occurrence l'arrêt du projet ? Et la cohésion du groupe, celle des couples - celui que forme Thomas et Klara - résisteront-elles à l'usure du temps, aux conditions atmosphériques, à la pression policière ?
Vous le saurez en lisant le livre d'Éric Pessan qui nous livre là un passionnant roman d'apprentissage, la radiographie d'un engagement et une leçon de politique donnée par la jeune génération. Indispensable en ces temps de fièvre démocratique.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 02:58) :
Le soleil est nouveau chaque jour – Éric Pessan – Médium+ de l'école des loisirs (186 pages, 14 €)
* fragment 88 dans l'édition de Marcel Conche aux PUF
vendredi 21 juin 2024
Quatre albums
Je ne vous parle pas assez souvent d'albums pour tout-petits, vous savez, ces livres qu'on leur lit le soir avant qu'ils ne s'endorment ou quand ils viennent vous voir dans la journée en vous disant d'un ton geignard « j'm'ennuiiiie ». Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de me rattraper en vous proposant quatre livres bien différents, démontrant si besoin était la variété des propositions des éditeurs.
Pourquoi ne pas commencer par ce « beau bouquet » composé par Lucie Brunellière ? L'argument en est simple. Un petit garçon se promène dans son jardin, chez sa voisine, à la campagne, il traverse une forêt, arrive au bord de la mer, et finit même par escalader une montagne pour vous présenter un superbe bouquet de fleurs qui veut tout simplement dire « je t'aime ». A l'arrivée, vous aurez mis un nom sur dix-neuf fleurs – si j'ai bien compté – et après les avoir rencontrées une à une vous pourrez inviter votre jeune lecteur (ou lectrice) à les reconnaître dans le bouquet final. Quitte à revenir en arrière pour retrouver l'endroit où telle ou telle a été cueillie, et son nom. C'est un album grand format, paisible, aéré, utile et le dessin est aussi précis que la couleur est chaude. C'est un album pour se souvenir des fleurs et oublier la pluie !
Un beau bouquet est publié aux éditions de L'agrume, sous la signature de Lucie Brunellière (44 pages, 16,50 €)
Aimez-vous l'Afrique ? Alors je vous propose de vous embarquer dans le taxi-brousse de Papa Diop. L'éditeur Syros a eu la bonne idée de rééditer dans un même volume l'histoire racontée par Christian Epanya à deux époques de la vie de Papa Diop. C'est Sène, le neveu qui expliquen d'abord comment et pourquoi son oncle a eu tant de succès en se lançant dans l'achat et l'exploitation d'un mini-bus sur la route entre Dakar et Saint-Louis, soit près de 260 km. L'auteur-illustrateur dépeint un Sénégal haut en couleurs à travers une série de scènes vivantes, toutes plus pittoresques les unes que les autres, qu'il s'agisse d'une fête nocturne, d'une périlleuse traversée à la saison des pluies, d'un mariage ou d'un enterrement. Papa Diop et son taxi-brousse sont toujours prêts à servir la communauté. Le taxi-brousse aurait coulé une retraite paisible au musée de l'automobile de Dakar si le jeune Sène devenu grand et gardien du musée en question n'avait eu l'idée d'aller saluer son oncle, lui aussi à la retraite. S'ensuit une nouvelle expédition du souvenir, à bord du taxi-brousse ranimé pour l'occasion. L'auteur illustrateur explique que le personnage de Papa Diop figure le Sénégalais moyen évoluant « dans un coin du monde où l'accueil et la joie de vivre sont élevés au rang de religion. »
Papa Diop et son taxi-brousse est un album grand format écrit et illustré par Christian Epanya et paru chez Syros (64 p, 15 €). A noter que deux QR codes permettent d'accéder gratuitement au livre audio, raconté par Thierno Diallo et accompagné par une musique instrumentale africaine.
Le troisième album que je voulais vous présenter est l'œuvre de l'illustratrice Juliette Armagnac, également autrice pour ce livre. Album bilingue, il s'inspire d'une comptine occitane destinée à endormir les enfants et intitulée SÒM, SÒM, qui signifie, « sommeil, sommeil ». C'est l'histoire d'un petit garçon qui voit le soir tomber et sent une présence diffuse dans la maison, quelque chose qui s'approche de lui et à laquelle il résiste comme il peut jusqu'au moment où elle s'empare de lui et l'entraîne dans un long voyage : le sommeil. De la chaise au lit, le décor se transforme, se fait onirique, aspire le petit garçon qui s'envole dans les bras de Morphée. De menaçant qu'il était le sommeil est devenu voyage dans les airs : comment ne pas s'y abandonner ? D'un dessin précis, réaliste, Juliette Armagnac campe un enfant solitaire aux prises avec ses émotions au seuil de la nuit qui vient. Et c'est aussi juste qu'apaisant, au plus près de ce mystérieux passage de la veille au sommeil qu'il s'agit d'apprivoiser pour repousser les fantômes qui l'accompagnent si souvent.
SÒM, SÒM, de Juliette Armagnac est paru aux éditions Arphivolis à Prayssas, dans le Lot et Garonne. C'est aussi un livre-atelier, accompagné de silhouettes à découper, à poser sur un cercle phosphorescent avec d'autres objets qui pourront composer la scène d'un rêve à venir, une vision rassurante sur laquelle s'endormir (26 pages, 19,50 €, dès 3 ans)
C'est samedi dernier, au salon de Champcevinel près de Périgueux, que j'ai rencontré Juliette Armagnac. Non loin d'elle, ZAD dédicaçait aussi les livres et les albums qu'elle a créés en compagnie de Didier Jean. Didier Jean et ZAD, voilà un fameux tandem d'auteur-illustratrice et je n'ai pas résisté à un album dont le titre m'a tout à fait paru de saison : « L'agneau qui ne voulait pas être un mouton ».
Soit un troupeau de moutons qui vivait paisiblement sur un pré, au bord d'une falaise. La couverture de l'album, montrant la gueule ouverte d'un énorme loup ne laissait rien présager de bon. Et de fait nuit après nuit, le loup vient se servir : un mouton malade, puis un mouton noir, puis une brebis et ses petits. Le troupeau ne réagit guère, lâchement résigné aux prédations répétées du loup. Seulement quand le loup s'attaque au bélier du troupeau, rien ne va plus. Privé de son chef, les moutons décident de réagir et c'est un petit agneau qui va servir d'appât et... de piège. Vont-ils réussir à se débarrasser du loup ? La fable de cet album, sélectionné par l'Education nationale et parrainé par Amnesty international, est transparente. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, l'album se conclut par le texte d'un pasteur protestant écrit au lendemain de la deuxième guerre mondiale :
L'agneau qui ne voulait pas être un mouton est un album écrit par Didier Jean et illustré par ZAD, paru chez Syros (40 pages, 7,50 €).
Pour écouter cette chronique :
vendredi 14 juin 2024
Le pays de sable
Avec Le pays de sable, l'école des loisirs vient d'éditer la sixième des Histoires naturelles de Xavier-Laurent Petit. Comme le souligne la présentation de l'éditeur, chacun de ces livres est « à la croisée de la fiction et du documentaire », sortes d'aventures écologiques auxquelles ses jeunes personnages sont confrontés, à la rencontre d'une nature tantôt accueillante tantôt sauvage, qui paraît souvent menacée.
Je vous avais présenté ici même, il y a déjà cinq ans, Les loups du clair de Lune, qui se passait en Tasmanie, la grande île au sud-est de l'Australie. Le pays de sable où Xavier-Laurent Petit nous entraîne cette fois, c'est le Sahara mauritanien.
Khadija revient au pays après quinze années d'absence. Elle a fait ses études en France, est devenue médecin, s'est mariée, mais son fils Yani n'a jamais rencontré son grand-père Hassen Ibn Alhamazen que tout le monde appelle dans son pays Mossi, qui veut dire « Maître »
Yani a dix ans, il est très impressionné par ce grand-père, qui très vite veut l'emmener en expédition dans le désert. Évidemment, Mossi tiendrait à partir seul avec son petit-fils, il a tant de choses à rattraper avec lui. Et puis, il est question d'une initiation, entre hommes, à la vie du désert. Khadija, qui en connaît les dangers, va-t-elle laisser Yani partir sans elle ?
Une fois cette question résolue, Yani se retrouve embarqué au cœur du désert où il va découvrir le métier de son grand-père : chamelier et la vie par 50° C, la soif, la faim, les étoiles qui guident les caravanes la nuit..
Yani va s'apercevoir à son corps défendant que le désert n'est jamais entièrement désert et surtout qu'il n'est pas peuplé que de gens recommandables...
Mossi met à l'épreuve son petit-fils comme s'il voulait en faire son successeur et l'ajouter à la lignée familiale des chameliers, de père en fils. Ce n'est pas tout à fait le projet de Yani ni de sa mère, mais en quelques jours, Yani va faire des découvertes fondamentales qui lui serviront toute sa vie. Mise à l'épreuve elle aussi par son père, Khadija n'aura de cesse de lui démontrer qu'elle a conservé en elle ses enseignements, répétant, comme une antienne filiale : « Abba, je n'ai rien oublié ».
Xavier-Laurent Petit dépayse radicalement son jeune héros et nous avec lui, nous offrant un superbe roman d'apprentissage et une leçon de dépouillement de soi.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 02:28) :
Le pays de sable (Histoires naturelles) – Xavier-Laurent Petit – Neuf de l'école des loisirs (203 pages, 12 €)
vendredi 7 juin 2024
Demain n'aura pas lieu
« Et vous, que feriez-vous s'il vous restait trois jours à vivre ? » Dans les remerciements qui servent de postface à son roman, Iuna Allioux explique que c'est cette question posée pendant une conversation entre amis qui a mis en route l'écriture de ce qui est devenu Demain n'aura pas lieu. Précisons tout de suite, car cette question pourrait être sujette à bien des interprétations, que l'héroïne du roman n'est pas condamnée par quelque maladie ou par une sentence de mort qui lui aurait été signifiée. Non, plus simplement, c'est le monde vivant qui va disparaître, grillé par notre soleil, ce bon vieux soleil qui aura été si longtemps notre bienfaiteur. Et la météo semble formelle : il gonfle, les astrophysiciens l'ont confirmé, et c'est pour dans trois jours. Il fait si chaud, de plus en plus chaud, qu'on ne peut pas douter, pour une fois, que cette prévision se réalise. Le suspense n'est pas là.
Asumi est une jeune adolescente née au Japon et venue en France à l'âge de sept ans avec sa mère, prénommée Gin. Maxence est son meilleur ami depuis leur première rencontre à l'école. Asumi a un autre ami très cher, un ryukin, nommé Dak-Ho, un poisson qui vit dans un grand bassin où elle aime le rejoindre, sous l'eau. Dernier trait d'Asumi : elle s'évanouit souvent et ces évanouissements sont en général précédés, accompagnés, suivis de séquences oniriques où elle semble revivre des événements du passé dont elle n'a pas la clé. Elle pourrait faire sienne cette phrase tirée d'une lettre écrite à Rodin par Camille Claudel : « il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente ».
La première absente, c'est sa mère qui dans cette période cruciale prend l'avion pour le Japon, laissant sa fille seule à Paris. Son travail l'appelle impérativement à Tokyo. Alors que chacun n'a qu'une hâte, c'est de se rapprocher des siens, hâte qui sature tous les moyens de transport, Gin est partie. Asumi ressent douloureusement ce départ. Heureusement, il y a Bo-Wang le restaurateur ami, Maxime et sa famille et Dak-Ho, le ryukin. Et surtout il y a Ji Eunji, un écrivain coréen dont Asumi est tombée amoureuse, de cet amour de tête que la distance nourrit et exténue à la fois. Elle lui a écrit, il lui a répondu et sa réponse est pour Asumi le plus précieux des viatiques. Quand elle apprend qu'il est en France, à Paris, elle fait tout pour le rencontrer. Y parviendra-t-elle ?
Curieusement, ce roman qui met en scène les trois derniers jours de l'humanité ne ressemble pas à un film-catastrophe ou apocalyptique, qui pourrait nourrir légitimement quelque éco-anxiété. Tout se passe comme si les destinées individuelles devenaient moins tragiques d'être prises dans une même fatalité, la fin collective de l'humanité. Parce qu'aussi à la faveur des événements qui se précipitent, des révélations sur son histoire personnelle vont lever les secrets qui entravaient Asumi et l'autoriser enfin à aimer et à être aimée. Juste avant la fin du monde.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:00) :
Demain n'aura pas lieu – Iuna Allioux – Sarbacane – (196 pages, 15 €)
vendredi 31 mai 2024
De délicieux enfants
Est-ce du lard ou du cochon ? De son propre aveu, c’est la question que Flore Vesco s’est posée après avoir mis un point presque final au manuscrit de ce qui allait devenir son troisième roman, De délicieux enfants. Flore Vesco, mes auditeurs fidèles la connaissent. Ils savent qu’elle a entrepris de revisiter les contes qui ont nourri tant d’enfances depuis Madame d’Aulnoye, Charles Perrault, les frères Grimm… En 2019, ce fut L’estrange malaventure de Mirella, puis en 2021 D’ors et d’oreillers, tous ouvrages couronnés de nombreux prix tant l’audace et la nouveauté de leur style et de leur langue ont saisi et séduit les lecteurs les plus aguerris. En 2024, notre autrice opère un nouveau détournement, celui du Petit Poucet et à nouveau elle rebat les cartes du conte, les brouille et nous embrouille au point que nous aussi, à la suite de l’autrice, nous ne savons plus jusqu’à la fin qui du lard ou du cochon va l’emporter dans ce récit.
Donc, il était une fois une famille, le père, la mère et les six, non pardon, les sept enfants, trois paires de filles et une petite ravisée surnommée Tipou, une pauvre famille dont le père bucheron a bien du mal à subvenir à ses besoins élémentaires. Pour tout dire, si l’affection la plus vive lie ensemble les parents à leurs filles et les filles à leurs parents, la disette règne avec la même vivacité et les choses ne vont pas s’améliorer quand sept garçons esseulés et affamés frappent à la porte de la chaumière, par une froide soirée d’hiver aussi mal chauffée que nourrie.
Des garçons ! Les sept filles n’en avaient jamais vu et très vite la curiosité de découvrir comment ils sont faits s’empare de ces demoiselles dont les aînées ont tout de même dix-sept ans. La nature étant bien faite, il semble que la fratrie venue se réfugier chez elles soit parfaitement homothétique à la sororie qui l’accueille, ce qui ouvre bien des perspectives.
Très vite, les deux minus de chaque tribu, Tipou et Poucet, la fille et le garçon, vont se lier et dans le concert des voix qui racontent, iels vont faire entendre les leurs, singulières.
Pendant ce temps, les garçons, de timides qu’ils étaient arrivés, prennent de l’assurance, se gonflent, tandis que les filles, toutes entreprenantes qu’elles étaient au début, semblent se rencoquiller dans des essais de féminité, quand elles décident, avec l’assentiment et la complicité de leur mère, qu’elles auront des jupes en place de leurs pantalons. Les garçons manqués du début deviendraient-elles des filles réussies mais n’ont-elles pas beaucoup à perdre dans cette mue qui paraît pourtant naturelle ?
Au fait, ne sommes-nous pas dans le Petit Poucet ? N’y avait-il pas un ogre, une sorcière ? Qui aiguise son couteau ? Quels maléfices vont surgir ? De famines en méprises, la chair fraîche des unes et des autres suscite des convoitises de toutes natures. Flore Vesco n’a pas son pareil pour faire surgir les images incongrues des plus secrets désirs, dans une langue qui réinvente la violence primitive des sentiments, l’attraction des corps, les épreuves nécessaires de l’amour et de la vie.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:18) :
De délicieux enfants - Flore Vesco - Medium + de l’école des loisirs - mars 2024 (216 pages, 15 euros)
vendredi 24 mai 2024
Les enfants de Chatom
Nous sommes en 1928, à Chatom, un petit village sans histoire en Alabama. Du moins, apparemment sans histoire, car s'il n'y en avait vraiment aucune, Thomas Lavachery n'aurait rien eu à vous raconter, à part que Miss Ruffo l'institutrice, fume la pipe.
Dans un village, il y a toujours un homme ou une femme, qui vit un peu à l'écart, qui n'embête personne et que personne n'embête. Chatom n'échappe pas à cette règle, grâce à Stumpy Malone, un bûcheron géant qui vit tout seul dans une cabane vide et froide. Tout le monde a bien remarqué qu'à l'approche de l'hiver, il disparaît pour reparaître au printemps, mais nul ne sait où il va et nul n'a jamais osé le lui demander. À chacun ses affaires!
Mais un beau jour, Sam Harriott, quatorze ans, se met au défi de percer le secret de Stumpy, aidé par Alice, la fille du drugstore. Il commence à surveiller ses allers et venues, comptant bien le filer quand il sortira de sa maison pour aller s'enfouir on ne sait où. Seulement un jour, Stumpy disparaît de nouveau, tel un magicien, sans laisser de traces. Ce que Sam et Alice vont découvrir dépassera tout ce qu'ils avaient imaginé, au point qu'ils s'engagent l'un et l'autre à ne rien révéler aux gens du village.
Thomas Lavachery raconte avec talent les riches heures d'un village solidaire dans l'adversité. On pense parfois à Mark Twain, à cette Amérique des gens simples qui se serraient les coudes et dont l'institutrice, le docteur et le curé, pour originaux qu'ils fussent chacun, suffisaient bien à leur bonheur, sans qu'il soit besoin d'un shérif.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 02:27) :
Les enfants de Chatom – Thomas Lavachery – Medium de l'école des loisirs – 2024 (205 pages, 13 €)
vendredi 17 mai 2024
Mon petit frère est une pastèque
Jules a quelques soucis. D'abord sa mamie est à l'hôpital. Ensuite sa maman est enceinte, « très, très enceinte », nous précise-t-il. Alors quand il va voir sa mamie avec ses parents, ses deux soucis sont réunis dans la chambre. Il aurait bien aimé ne pas rater l'épisode de son feuilleton préféré, Belzébouk, le diablotin de l'espace, mais malheureusement, il n'y avait qu'une télévision pour deux et la voisine de chambre de mamie, une très vieille dame, avait décidé qu'elle était la cheffe de la télécommande et n'a pas voulu la prêter à Jules .
Le ton est donné. C'est Jules qui raconte et l'auteur nous installe dans sa tête de petit bonhomme qui met des mots là où ils font défaut, aussi bien dans une chambre d'hôpital, qu'à la maison, à l'école ou dans la cour de récréation.
Comme ses parents n'ont pas l'air d'être d'accord sur le prénom à donner au petit frère à venir, Jules a décidé de l'appeler Bananiol, comme le chocolat en poudre qu'il prend tous les matins.
Heureusement, mamie est remise sur pieds pour apprendre à Jules qu'il va avoir un petit frère car ses parents sont partis à la maternité pendant qu'il dormait. Commence alors pour Jules une vie étrange. Sa mamie passe sa journée au téléphone en répétant « ça va aller, ça va aller » et elle oublie d'emmener Jules à l'école. Le lendemain, ses parents reviennent à la maison, sa maman a le ventre tout plat et elle pleure et quand Jules demande à son papa où est Bananiol, il ne sait que lui dire, en le serrant contre lui : « ça va aller ».
Le deuxième jour, toujours pas d'école. Comme il sent confusément qu'au contraire, rien ne va plus aller, il s'invente un délire en découvrant dans le frigo une énorme pastèque : c'est elle, Bananiol, c'est lui, son petit frère que ses parents ont caché au frais car ils en avaient honte. Mais lui, Jules, va le tirer de là. Il emporte la pastèque dans sa chambre et la glisse sous son lit, ni vu ni connu. Bananiol est sauvé.
Dès lors, Jules s'invente une vie avec Bananiol qu'il va imposer à Kevin et Fatoumata ses deux complices, à la maman de Kevin qui fête son anniversaire, à tous ces adultes qui lui offrent leur sollicitude attendrie que nous sommes seuls à comprendre.
L'auteur nous entraîne, lui, à imaginer le pire, que l'existence de Bananiol ne suffit pas à conjurer. Mais, c'est bien connu, le pire n'est jamais sûr, le dénouement nous le confirmera.
Laurent Rivelaygue se laisse porter par l'invention de Jules qui impose sa surréalité à un entourage qui ne parvient pas à lui dire la simple vérité, suspendu dans une attente parallèle. On retrouve avec plaisir les illustrations d'Olivier Tallec, dans l'esprit de la série les Quiquoi, du même tandem. Le lecteur est embarqué lui aussi, appréhendant le moment où cette bulle fictionnelle éclatera, comme un chagrin trop longtemps contenu. Mais si les parents de Jules avaient eu les mots pour dire, aurions-nous eu une histoire ?
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:15) :
Mon petit frère est une pastèque – Laurent Rivelaygue et Olivier Tallec – Neuf de l'école des loisirs – à partir de 6 ans (57 pages, 9 €)
vendredi 3 mai 2024
Mes amis devenus
Voilà, j'ai commencé ce livre hier soir, j'ai éteint ma lampe à regret pour dormir et je l'ai terminé ce matin. Avait-il bercé ma courte nuit ? Je ne sais, mais il m'a cueilli au réveil et ne m'a pas lâché. Et je m'aperçois, oh, scandale que depuis toutes ces années, je ne vous avais jamais présenté un seul ouvrage de Jean-Claude Mourlevat, l'un des auteurs jeunesse français les plus célèbres, justement couronné en 2021 du prix international Astrid Lindgren. Il a dernièrement inauguré chez Gallimard une série, Jefferson, qui met en scène un hérisson détective. Mais vous avez sûrement entendu parler de ses premiers romans, à la fin des années 90 : La balafre, L'enfant Océan, La rivière à l'envers, etc.
Mes amis devenus, c'est le titre que je viens de lire de lui, n'est pas précisément un livre paru dans une collection pour la jeunesse mais je crois qu'il peut plaire à n'importe quel adolescent qui se retrouvera dans ce « Club de Cinq » pour grands.
Quand le roman commence, Silvère vient à Ouessant ouvrir une maison qu'il a louée pour quelques jours. A l'instigation de Jean, un ami de collège que Silvère n'a jamais perdu de vue car il a toujours été comme un frère pour lui, cinq amis, trois garçons et deux filles, je devrais dire trois hommes et deux femmes, sont tombés d'accord pour se retrouver et passer cinq jours ensemble sur l'île, quarante ans après s'être quittés. Ils sont convenus de venir seuls, sans leurs attaches actuelles éventuelles, maris femmes ou enfants, provisoirement mises hors jeu pour la durée du séjour.
A 17 h, Silvère est donc arrivé au port en bicyclette et il guette l'arrivée du ferry qui lui amène Jean, Lours', Luce et Mara. Il les attend le cœur battant, battu par le passé qui lui revient par vagues, se demandant s'il les reconnaîtra, s'ils le reconnaîtront. C'est dans cette attente que Silvère, le narrateur, glisse le récit de son enfance et de son adolescence bientôt mêlé à celles des quatre ami·es qui vont le rejoindre. Commence une longue analepse qui arpente les territoires puissants de la famille, de l'amitié et des premières amours.
Mes amis devenus est un authentique roman d'apprentissage. Silvère, qui raconte, en est le personnage central, brûlé intérieurement à la pensée qu'il va revoir Mara, son amour d'adolescence, le premier, le seul peut-être, « passion immédiate et dévorante », qui lui a échappé. C'est cette corde tendue de Silvère à Mara qui vibre tout au long du roman, résonance du passé dans le présent de ces retrouvailles. Qu'est-ce qui reste du bonheur des premiers commencements, des galères, des fous-rires, des trahisons aussi, que le temps a repeints des couleurs chaudes et dégradées de l'automne, en ce début d'octobre.
Chacune des journées passées va avoir sa tonalité au fil des relectures et révélations que chacun va faire de sa vie ultérieure à l'aune de ses débuts, revisités.
C'est un roman qui pourrait céder à la nostalgie, à l'amertume de la complainte Pauvre Rutebeuf interprétée jadis par Léo Ferré, à laquelle Jean-Claude Mourlevat a emprunté son titre. « Que sont mes amis devenus/que j'avais de si près tenus/Et tant aimés ? ♫». Si ces sentiments peuvent effleurer le lecteur d'un certain âge – j'emploie volontairement cet euphémisme - touchant en lui des zones sensibles de son passé, nul doute que ce livre fournira aux plus jeunes des repères pour situer ce qu'ils éprouvent et expérimentent aujourd'hui en l'inscrivant dans un horizon temporel élargi.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:00) :
Mes amis devenus – Jean-Claude Mourlevat – 2016 - Fleuve éditions (218 pages, 17,90 €)
vendredi 26 avril 2024
Sans crier gare
Aimez-vous les livres qui simultanément ou dans un ordre quelconque vous font peur, vous font pleurer et vous font rire tant et tant que vous ne les reposez qu'à contrecœur pour manger ou dormir et n'avez qu'une hâte, les rouvrir pour continuer votre lecture jusqu'à la dernière page ?
Alors celui que je viens de terminer est pour vous.
Nous sommes à l'été 1968, aux Etats-Unis. La guerre au Vietnam fait rage. Meryl Lee Kowalski, une teen-ager new-yorkaise, vient de perdre son meilleur ami Holling Hoodhood dans un accident de voiture stupide, alors qu'il allait voir un film stupide. Un Gouffre s'est alors ouvert sous ses pieds, qui se referme et se rouvre sans crier gare. Ses parents jugent urgent de dépayser leur fille d'un endroit où tout lui rappelle son Holling perdu à jamais et l'envoient poursuivre sa scolarité dans l'école de jeunes filles Sainte-Elene. Le jour de la rentrée, Meryl Lee est désespérée comme un chiot abandonné sur une aire d'autoroute quand la voiture de ses parents finit par quitter l'école malgré toutes ses supplications. Comment va-t-elle pouvoir survivre dans l'univers corseté du collège, à côté de riches pimbêches qui ne la calculent même pas ? C'est ce que le roman de Gary Schmidt raconte au long de ses quelque 460 pages.
Mais pas que. Car parallèlement aux destinées scolaires de ces demoiselles, se joue celle de Matt Coffin, un ado sauvage en fuite pour lequel Mme Nora MacKnockater, la principale du collège de Meryl Lee, va se prendre d'affection, on comprendra pourquoi plus tard. Que fuit Matt, serrant contre lui un taie d'oreiller bourrée de billets de 100 $ ? L'auteur va nous distiller peu à peu, à coups de retour en arrière, son itinéraire pour le moins effrayant. L'homme qui le traque, Leonidas Shug, ne le lâchera pas, se vengeant sur tous ceux qui auront aidé Matt dans sa fuite. Pourrait-il aussi s'attaquer à Mme MacKnockater, auprès de qui Matt a enfin trouvé un foyer ?
Il paraît que les parallèles se rejoignent à l'infini. Se pourrait-il que les destinées de Matt et de Meryl Lee se rencontrent avant ce terme improbable ?
La lecture de Sans crier gare se nourrit de cet espoir, si mince soit-il, il ne faut pas se le cacher. Entre la vie de jeunes collégiennes que leurs enseignantes destinent aux plus hauts Accomplissements (avec un A majuscule) et celle de Matt qui vit dans la terreur d'être retrouvé par celui qui a tué son meilleur ami, il n'y a pas grand rapport. Pourtant, pourtant... Ah, vous verrez bien. Lisez Gary D Schmidt !
Ce roman est le troisième d'une trilogie qui commence avec La guerre des mercredis que j'aurais pu vous présenter en 2016 si j'avais déjà sévi à l'époque sur cette antenne. J'avais presque oublié Gary Schmidt et combien ce qu'il écrivait faisait du bien à ses lecteurs. Comme j'ai oublié de lire le deuxième volet, Jusqu'ici, tout va bien, oubli que je vais me dépêcher de réparer. Pourquoi hésite-t-on à tout lire d'un auteur qu'on a aimé une fois ? Par peur d'être déçu ? Si on aime, n'est-ce pas pour toute la vie ?
Je vais me répéter mais la traductrice, Caroline Guilleminot, a su rendre avec une précision millimétrique un récit sous understatement permanent, vous savez ce style fait de litotes, d'euphémismes, qui dit les choses sans les dire tout en les disant et qui vous cueille régulièrement au détour d'une ligne, au moment où vous ne vous y attendez pas, d'un rire ou d'un sanglot, quand il ne vous fiche pas carrément la trouille.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:27) :
Sans crier gare – Gary D. Schmidt – traduit de l'anglais (États-Unis) par Caroline Guilleminot – Medium+ de l'école des loisirs (462 pages, 19 €)
vendredi 19 avril 2024
Les Mille vies d'Ismaël
C'est un peu étrange de penser qu'on est au bout de sa vie alors même qu'on ne l'a pas encore commencée. C'est pourtant le sentiment qu'éprouve Ismaël, 15 ans, quand il se fait exclure temporairement de son collège, dans l'attente d'un conseil de discipline qui pourrait bien décider de l'en éjecter définitivement, juste avant le Brevet.
Sa mère, qui n'en peut plus de lui, l'expédie chez un oncle qui habite Lyon et qui, surprise, lui obtient un stage en cuisine dans un p'tit bouchon, comme on nomme là-bas les restaurants qui perpétuent les traditions des « Mères » de la cuisine lyonnaise.
Le Baron perché est dirigé par un Chef, Francis, qui tient sa petite équipe d'une main de fer : Ismaël n'était pas préparé à intégrer un véritable commando mais il en découvre rapidement l'effervescence et contre toute attente, ça lui plaît. Ce qui lui plaît aussi et surtout c'est Céleste, la fille aux yeux verts dont il tombe amoureux le premier jour, même s'il ne le sait pas encore, même s'il est à mille lieux de croire qu'il pourrait intéresser une fille comme elle, lui le métis en surpoids et en dreadlocks, toujours planté devant son ennemi n° 1 : le Frigo.
C'est qu'Ismaël porte un lourd secret, vieux de cinq ans, qui a mis son père en prison et sa vie en pause. Il n'arrive plus à avancer, ne fait que des conneries. La cuisine du Baron perché va le remettre en route.
On travaille beaucoup dans la restauration, avec une intensité qui culmine au moment du coup de feu et qu'on n'imagine pas, quand on est un client assis dans l'ambiance feutrée de la salle.
L'autrice des Mille vies d'Ismaël, Raphaëlle Calande, nous fait pénétrer au cœur de ce travail d'équipe, une chaîne dont tous les maillons sont solidaires, dans la réussite comme dans l'adversité : Nicolas, Djibril, Katal et Céleste, en cuisine, Malika et Quentin au service et Francis, le chef d'orchestre. Avec eux, grâce à eux, Ismaël va s'ouvrir mille vies.
Logé chez son oncle et sa tante, Ismaël côtoie aussi leurs enfants, ses cousins et cousines, Juliette, Andréa et Lukas l'autiste, qu'il va apprendre à mieux connaître.
L'autrice nous fait aussi pénétrer dans le monde nocturne des graffeurs qui hantent les toits de Lyon, les squats, pour y laisser l'empreinte de leur passage et leur « blaze », cette signature colorée et inimitable inscrite, sur des surfaces a priori inaccessibles au commun des mortels. C'est un monde parfois dangereux, où des groupes racistes d'extrême-droite tentent de faire régner leur loi à coups de battes et de couteaux...
Si un roman mérite d'être qualifié d'apprentissage, c'est bien celui-là. La remise en route et l'éclosion d'Ismaël en sont l'épicentre, mais, autour de lui, Raphaëlle Calande brosse le portrait attachant de toute une jeunesse qui cherche sa voix et sa voie, sous le regard d'adultes toujours prêts à leur refaire confiance, malgré les erreurs et les bêtises. Peut-être parce que ces adultes n'ont pas complètement oublié les leurs et qu'ils sont encore capables, eux aussi, d'en faire...
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:04) :
Les Mille vies d'Ismaël et quelques saveurs en plus – Raphaëlle Calande – X' Sarbacane (349 pages, 17,50 €)
vendredi 12 avril 2024
Le Soleil, la Lune et toi.
Evidemment, l'album consacré au Soleil est nettement plus lumineux et aurait tendance à éclipser (ah, ah !) son jumeau, qui parle de la Lune. Mais les deux ont été écrits par Cléa Dieudonné qui fait toute la lumière sur ces deux astres qui nous sont aussi familiers qu'inconnus.
Par exemple, saviez-vous... Non, je ne vais pas commencer à vous poser des questions qui pourraient vous mettre en difficulté et auxquelles moi-même je n'aurais pas su répondre avant d'avoir lu et relu ces deux beaux albums cartonnés qui ne redoutent pas les petites mains hésitantes.
Vous apprendrez quand même que le Soleil n'est pas né dans un chou, que les huit planètes qui tournent autour de lui sont distribuées autour d'une ceinture d'astéroïde. En deçà, il fait un peu chaud, au-delà il fait très froid. La Terre est du côté chaud mais son atmosphère nous a évité jusqu'ici de griller.
Avec la Lune, notre plus beau satellite - les autres sont artificiels, c'est toute la ferraille que nous envoyons en orbite depuis soixante ans et quelque - vous découvrirez ce qu'est la force d'attraction, pourquoi elle change de forme, du premier au dernier quartier, toussa toussa.
En bref Cléa Dieudonné m'a fait faire d'utiles révisions d'astronomie et je vais pouvoir continuer à chanter "Le Soleil a rendez-vous avec la Lune ♫"
Pour écouter cette chronique :
Le Soleil et toi - La Lune et toi - Cléa Dieudonné - albums cartonnés à partir de 5 ans, accompagné - L'Agrume - 2024 (64 pages, 14 €)
vendredi 5 avril 2024
Wendigo
vendredi 29 mars 2024
Un zoo à soi
Vous connaissez peut-être Thomas Lavachery, l'écrivain belge dont l'école des loisirs a publié les aventures en huit tomes de Bjorn le Morphir, une série d'héroïque fantaisie. J'ai découvert et lu d'une traite un livre très personnel, autobiographique, où il relate comment il a passé son enfance au milieu d'une véritable ménagerie. La faute, ou plutôt la grâce à son père, élevé chez Decroly, le Célestin Freinet belge, et passé par le scoutisme, deux écoles de liberté et de plein air qui lui ont donné le goût de l'observation des animaux et de la nature.
Thomas Lavachery rapporte d'ailleurs une anecdote qui en dit long sur cette éducation paternelle. Un jour, la famille est à table et un moineau se pose sur la rampe de l'escalier qui mène au jardin. Le père s'exclame, avec toute la précision ornithologique qui était la sienne : « Tiens, un accenteur mouchet », là où toute la famille n'avait vu qu'un vulgaire piaf.
Les compagnons à poil et à plumes n'ont pas manqué à Thomas. Cela ne l'a pas mithrisatisé toutefois et il se désole d'être devenu sur le tard allergique même à son chat préféré, un chartreux nommé Panku, dont il ne se séparerait pourtant pour rien au monde.
Le petit livre de Thomas Lavachery dévide le bestiaire d'une vie, la place qu'y ont pris des animaux de toutes sortes, parfois improbables dans une maison, comme un écureuil ou une chèvre, sans oublier les vivariums, toutes bestioles adoptées au fil du temps par ses parents, « dans la plus merveilleuse insouciance », se souvient-il.
Quand une petite sœur, elle aussi adoptée, est arrivée au foyer, venant de Corée, son regard émerveillé sur le zoo familial a semblé l'agrandir encore. Mee-Kyong s'est attachée très vite à tous les animaux de la maison Lavachery, au point d'entrer comme apprentie dans une animalerie, dès l'âge de 15 ans.
Thomas Lavachery, dont on sait par ailleurs les talents de bédéiste, a illustré chacun de ses chapitres d'une image taillée à la pointe du crayon, portraits précis des animaux qu'il a côtoyés, parmi lesquels il a glissé celui de son père et de sa petite sœur, auxquels son livre rend un hommage aussi attendri que vibrant. En rappelant tous les animaux de sa vie par leur nom, c'est aussi toute sa famille qu'il convoque avec eux, recomposant l'arche de Noé dans laquelle il a grandi.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 02:22) :
Un Zoo à soi – Thomas Lavachery – Medium de l'école des loisirs (123 pages, 7,80€)
vendredi 22 mars 2024
Les étincelles invisibles
Nous sommes à Juniper, un petit village écossais proche d’Edimbourg. Adeline, dite Addie, a 11 ans et deux sœurs jumelles plus grandes, Nina et Keedie. Keedie vient d’entrer à la fac et Nina, pour l’heure, est YouTubeuse beauté. Addie est autiste et grâce à elle, nous allons découvrir de l’intérieur ce que vit une autiste, quel est son rapport au monde et aux autres et comment se manifeste sa différence.
En cours avec Mlle Murphy, Addie apprend un jour qu’au Moyen âge, les habitants de Juniper ont accusé des femmes de sorcellerie, les ont torturées et les ont soumises à une épreuve qui les conduisait soit à la noyade soit à la pendaison, ne leur laissant dans tous les cas aucune chance.
Cette histoire bouleverse Addie. Elle devient obnubilée par le sort de ces femmes qui ont été oubliées. Est-ce parce que leur marginalité lui rappelle la sienne ? Elle décide de soumettre au conseil du village une proposition : ériger un mémorial en l’honneur de la cinquantaine d’entre elles qui ont péri d’une manière aussi atroce, par la faute des villageois de l’époque et des autorités ecclésiales.
Si elle rencontre d’abord le scepticisme du conseil et surtout l’opposition de son président, qui ne voit pas l’intérêt pour son village de remuer cette vieille histoire, Addie ne va pas lâcher l’affaire, soutenue par sa famille et par Audrey, une nouvelle, une Anglaise qui arrive dans sa classe, en provenance de Londres et qui va devenir peu à peu son amie. Sa première amie.
Dans sa famille, Addie peut compter sur une alliée, qui la comprend pour ainsi dire de l’intérieur : Keedie est autiste elle aussi et pour cette raison se sent plus proche de sa petite sœur que de sa jumelle, Nina. Et surtout, ce qui aura une importance pour la suite du récit d’Elle McNicoll, Keedie a eu la même institutrice qu’Addie, la redoutable Mlle Murphy…
Le livre s’appelle Les étincelles invisibles. C’est par cette appellation poétique que l’autrice, elle-même autiste, décrit les sensations qu’elle éprouve quand les situations qu’elle doit affronter provoquent une surstimulation de toute sa personne, conduisant à des réactions excessives souvent incompréhensibles pour son entourage, incapable d’en repérer les causes. Les autistes ressemblent à des écorchés vifs, hypersensibles aux sons, aux bruits, au toucher. Les contacts corporels, les manifestations d’affection que nous, les « neurotypiques », trouvons naturelles, déclenchent en eux des réactions imprévisibles. D’une façon générale, les autistes sont « trop » et c’est ce « trop » qu’Elle McNicoll nous fait découvrir au fil de son roman en suivant parallèlement deux trames : les démêlées d’Addie, proches du harcèlement, avec son enseignante et certaines élèves qui ne la supportent pas ; son combat pour obtenir de son village qu’il érige ce mémorial dédié aux sorcières de Juniper.
Le livre d’Elle McNicoll est plus qu’une simple leçon d’empathie et de tolérance vis-à-vis des autistes. En nous faisant vivre de l’intérieur la vie de l’une d’entre elles, il nous fait prendre conscience de tout ce que nous avons peut-être bridé nous aussi de notre sensibilité pour paraître « normaux », nous intégrer à la société et la supporter, jusqu’à parfois renoncer à être nous-mêmes. Addie a une expression pour ça : « faire le caméléon ». Autrement dit, pour nous, les neurotypiques, se résigner au conformisme.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:13) :
Les étincelles invisibles – Elle McNicoll – traduit de l’anglais par Dominique Kugler - Medium de l’école des loisirs (207 pages, 13,50 €)
Le coeur, le corps & tout le reste
Jonas a 13 ans, les hormones le travaillent et la culpabilité aussi, mâtinée d'une forme de dégoût. Depuis que la pornographie s'est...

-
Jonas a 13 ans, les hormones le travaillent et la culpabilité aussi, mâtinée d'une forme de dégoût. Depuis que la pornographie s'est...
-
Un miracle de littérature Clémentine Beauvais avait au moins mille mauvaises raisons de ne pas écrire ce livre consacré à la vie de Marguer...
-
Comment parler aux enfants de la grave maladie qui s'est invitée dans la famille, en l'occurrence le cancer de maman ? Pascale Bo...