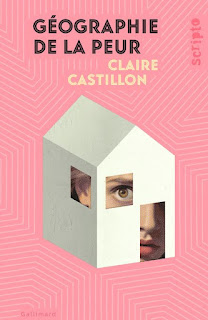J'ai découvert Claire
Castillon avec son roman Les longueurs, que je vous avais
présenté ici même en octobre 2022 et qui avait reçu quelques
jours plus tard le prix Vendredi. La croisant la semaine dernière
dans le cadre du Livrodrome qui stationnait à Lons-le-Saunier, j'ai
acheté son nouveau livre, intitulé Géographie de la peur.
Claire
Castillon nous entraîne cette fois-ci à l'intérieur de Maureen,
une jeune fille de 18-19 ans, qui souffre d'un TAG – non, un TAG,
ce n'est pas un graffiti tracé sur un mur, c'est l'acronyme pour
« trouble anxieux généralisé ». Elle vit encore chez
ses parents et a le plus grand mal à sortir de chez elle pour aller
à la fac.
L'autrice
a confié la narration à Maureen, qui se fait pour nous géographe
de sa peur, nous entraînant dans les méandres de son esprit. Qui ne
connaît pas aujourd'hui un ado qui n'arrive plus à se lever le
matin pour aller au collège ou au lycée, un jeune auquel en
désespoir de cause on a collé l'étiquette de « phobique
scolaire » ? Ou bien quelqu'un qui a de soudaines et
incompréhensibles « attaques de panique » dans la rue,
dans un magasin ? Cette cause désespérée, l'héroïne de
Claire Castillon nous la fait explorer, en compagnie de ses parents,
de son frère Alex, de Jérôme son infatigable ami et de quelques
camarades de classe qu'elle n'a pas encore totalement lassés avec ce
qu'ils nomment tous son « truc ».
C'est
que faute d'identifier une cause, faute d'entrer dans un catalogue de
maladies répertoriées, le mal-être de Maureen, son « truc »,
reste inclassable. Elle nous répète à plusieurs reprises qu'elle
est ainsi depuis dix-neuf mois, ce qui laisse penser au lecteur qu'un
événement traumatique est à l'origine de son état mental et de
ses malaises, que cet événement va nous être décrit, et qu'il
nous fera comprendre quelque chose.
En
attendant cette révélation, Maureen galère, n'arrivant plus à
sortir de chez elle. L'autre pilier dans sa vie, en dehors de Jérôme,
c'est son psy, le Dr Mary dont elle a dû concéder l'emploi à ses
parents mais dont le leitmotiv - « et vous, qu'est-ce que vous
en pensez ? » - ne suffit pas toujours à donner du sens
aux séances et à la vie de sa patiente.
Au
bout de quelques mois, un emploi d'hôtesse va fournir à Maureen
cette sorte d'armure qui lui manquait pour affronter le monde qui
l'entoure, qu'elle perçoit tout en aspérités et en reliefs
menaçants. Alors qu'elle avait régulièrement, lors de ses crises,
la sensation de se détacher intérieurement d'elle-même, ce qui la
conduisait à une sorte de paralysie de son être, ses fonctions
d'hôtesse lui permettent en quelque sorte de se dédoubler plus
objectivement et de confier à un personnage, en uniforme, le soin
d'affronter le monde extérieur à l'aide de comportements codifiés,
par une sorte de pilotage automatique.
La
caméra subjective de Claire Castillon entraîne le lecteur dans le
vertige intérieur de Maureen, avec une force saisissante.
L'incommunicable nous est communiqué pendant que l'entourage de la
jeune femme semble rester à l'extérieur, incapable d'interpréter
correctement les signaux désordonnés qu'elle lui envoie. Peu à peu
pourtant se dessine un chemin, qu'on dirait de « résilience »,
peut-être parce qu'en dépit des maladresses des uns des autres,
Maureen n'est pas rejetée et reste entourée. Du moins Claire
Castillon a-t-elle voulu qu'il en soit ainsi et que Maureen puisse
entrevoir la sortie de cette « cage invisible » dont elle
a elle-même, comme elle le dit, « dessiné les contours afin
de se protéger de son cerveau ». Par une boucle du récit,
l'autrice suggère in fine que l'écriture aura été une voie de
salut pour son héroïne, manière peut-être pour Claire Castillon
de nous dire quelque chose d'elle-même.
Pour écouter cette chronique (extrait lu à 03:42) :
Géographie de la peur – Claire Castillon – collection Scripto, Gallimard
Jeunesse (165 pages, 10,50 €)